Perché au cœur du Bas-Maine, le château de Courceriers (Mayenne) porte encore les traces de près de 1 000 ans d'histoire. Entre ruines médiévales, légendes de chevalerie et transformations architecturales, ce site emblématique, aujourd'hui protégé au titre des Monuments historiques, reste un précieux témoin du passé.
Mentionné dès le XIe siècle dans le cartulaire de Saint-Vincent du Mans, le site de Courceriers s'organisait autour d'une motte castrale, d'un donjon, d'une basse-cour, d'une chapelle et d'un étang servant à la fois de défense et de réserve d'eau.
Les ruines du donjon, hautes de plus de 15 mètres, datent probablement des XIIIe-XIVe siècles. On y distingue encore l'éboulement spectaculaire de l'entrée, jadis défendue par une double porte, une herse et des tours percées d'archères. Le château est aussi lié à l'un des grands chevaliers de la guerre de Cent Ans, Ambroise de Loré. Fidèle compagnon de Jeanne d'Arc jusqu'au sacre de Charles VII en 1429, il devint ensuite prévôt de Paris. Issu de la famille de Courceriers, son exact lien de parenté avec Guillemette de Courceriers reste discuté par les historiens.
- À lire aussi : Sud-Mayenne. "Un rêve de petite fille" : à 71 ans, elle rachète un château du XIe siècle
Durant ce conflit, la forteresse subit de violents assauts et fut détruite par les Anglais en 1419. En 1590, la famille du Plessis-Châtillon fit bâtir un nouveau logis face aux vestiges médiévaux. Guillaume du Bois agrandit ensuite l'édifice au milieu du XVIIe siècle, lui donnant deux ailes reliées par une tour coiffée d'une toiture à bulbe. Au XIXe siècle, M. Violas reconstruisit une aile dans un style néo-gothique, mais la plupart de ces ajouts disparurent en 1961. Seule subsiste aujourd'hui la tour centrale à toiture bulbeuse, dernier vestige de cette époque. À 500 mètres du château, une grande allée bordée d'arbres menait au Portail, aménagé au XVIIe siècle par Guillaume du Bois. Ce pavillon monumental, daté de 1657, allie élégance et symbolique sociale : passage voûté, frontons cintrés, pigeonnier en hauteur et toiture de type Philibert Delorme. Autour, la maison du garde en granit, dotée de cheminées sculptées, et les dépendances rappellent l'organisation seigneuriale du domaine. Depuis 1987, plusieurs éléments du château sont protégés. Un classement qui consacre la valeur architecturale et patrimoniale de ce site exceptionnel, à la fois témoin de l'histoire militaire du Bas-Maine et joyau d'architecture classique.
La chapelle des Rues, sauvée par les habitants
Probablement édifiée au XVIIe siècle, la petite chapelle des Rues a connu une première restauration en 1848 grâce à la famille Duval. Lieu de dévotion local, elle accueillait offices religieux et rogations jusque dans les années 1970. On y amenait aussi les enfants ayant des difficultés à marcher. Récemment restaurée, la chapelle a révélé un trésor inattendu : sous l'ancien autel en bois a été mis au jour un autel en pierre abritant une pierre tombale du XIVe siècle, sans doute issue de l'ancienne église ou du cimetière du bourg.
Au début des années 2000, l'édifice menaçait ruine. Sensibilisée à son état, Geneviève Mariette entreprit en 2003 de l'inscrire au concours du Pèlerin "Un patrimoine pour demain". Bien que non retenu, ce projet déclencha une dynamique locale : l'association Ensemble pour l'environnement et le patrimoine à Saint-Thomas prit le relais, soutenue par la municipalité. Grâce à la mobilisation des bénévoles et à des financements divers, la chapelle a retrouvé tout son éclat, symbole d'un attachement profond des habitants à leur patrimoine.
Les fours à chanvre, mémoire d'un savoir-faire
La commune conserve également plusieurs fours à chanvre situés au Plessis, au Bas-Aunay et au Bas-Bossuault. Construits en granit au XVIIIe siècle, ils témoignent d'une culture autrefois essentielle en Mayenne.
Le chanvre servait à confectionner toiles domestiques, vêtements, papiers (billets de banque, papier bible, papier à cigarettes) et surtout cordages pour la marine à voile, qui en consommait plusieurs tonnes par navire. Ces fours, organisés en deux parties - une chambre de chauffe en bas et une chambre de séchage en haut -, rappellent l'importance de ce savoir-faire local, tombé en déclin à la fin du XIXe siècle avec l'essor du coton et des textiles synthétiques.
Deux moulins à eau se dressaient côte à côte au bord de la Vaudelle : un moulin à foulon et un moulin à farine. Si le premier cessa son activité au XIXe siècle, le second continua de faire tourner ses deux paires de meules pour nourrir la commune et même exporter sa production.
Grâce à la force constante de la rivière et des étangs alentour, le moulin de Courceriers fonctionnait encore en été, quand d'autres s'arrêtaient faute d'eau. Remanié à plusieurs reprises aux XIXe et XXe siècles, il demeure un précieux témoin de l'ingéniosité hydraulique d'autrefois.
Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nousEnvie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous











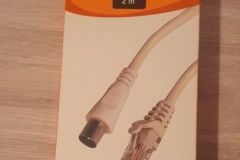






L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.